
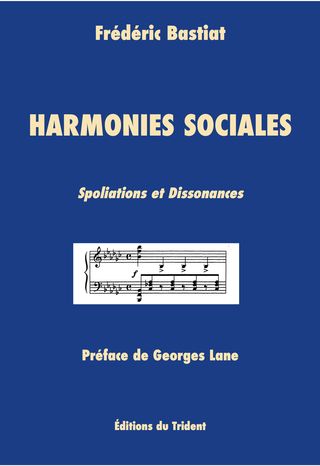 Le désarroi du pays devant le délitement du pouvoir politique devient de plus en plus préoccupant. Il amène, à ce qu'il paraît, la croyance en une perspective d'explosion sociale. Un récent sondage Ifop (1)⇓ tend à démontrer que "76 % des Français s'attendent à une explosion sociale". La moitié des Français (49 %) jugeraient ainsi "probable que la France connaisse une explosion sociale dans les mois qui viennent" et plus d'un quart (27 %) l'estimeraient même "certaine". Bigre.
Le désarroi du pays devant le délitement du pouvoir politique devient de plus en plus préoccupant. Il amène, à ce qu'il paraît, la croyance en une perspective d'explosion sociale. Un récent sondage Ifop (1)⇓ tend à démontrer que "76 % des Français s'attendent à une explosion sociale". La moitié des Français (49 %) jugeraient ainsi "probable que la France connaisse une explosion sociale dans les mois qui viennent" et plus d'un quart (27 %) l'estimeraient même "certaine". Bigre.
Mais attention : ceux qui la "jugent probable" ne la considèrent pas nécessairement comme "souhaitable". Encore moins se préparent-ils à mettre la main à la pâte pour faire exploser le dispositif...
On doit, en effet, toujours se méfier de ce type de pronostics. Lorsqu'on regarde un peu plus le détail de l'étude, on découvre que les électeurs supposés les plus convaincus que "ça va craquer" se retrouvent voter pour l'UDI. Ce public, même convaincu de l'imminence de la crise, reste probablement encore fort peu déterminé à faire face aux charges des gardes républicains place de la Concorde.
Remarquons aussi que personne ne sait au fond ce que veut dire "explosion sociale". Dans les années 1960 on prétendait qu'une telle déflagration se produirait inéluctablement si le taux de chômage atteignait 3 %.
Le gros des mécontentements, après un an de malaises et de manifestations autour de la loi Taubira, s'est déplacé en partie vers la question fiscale. Mélenchon a encore cherché à exhumer le fantôme de la "révolution fiscale" de Piketty : or, le 1er décembre, on a enregistré moins de manifestants à Paris pour le front de gauche que pour les bonnets rouges à Carhaix.
La vérité de tous ces remous, la leçon de toutes ces études récentes sur l'opinion des Français tend surtout à prouver l'universalité de leur mécontentement et le choc insoluble des intérêts corporatifs gérés par l'État.
Même si le concept d'une "explosion sociale" future reste flou, on ne peut donc que déplorer cette "implosion nationale". L'État ne peut évidemment plus rien gérer de manière satisfaisante. Et, de plus, il ne dispose d'aucun critère d'arbitrage accepté entre les intérêts figés, qui se considèrent tous comme prioritaires, cela va de soi, de l'École avec un grand É à la Santé avec un grand S, en passant par l'Intégration, etc.
La seule manière recevable d'apporter des solutions consiste dès lors à élargir le libre choix des gens : libre entreprise, liberté du travail, libre échange, liberté du commerce et de l'industrie, etc.
Ceci rend plus actuelle que jamais la pensée la plus fine et la mieux élaborée parmi celles des fondateurs français de cette défense des libertés : Frédéric Bastiat.
On connaît, ou plutôt on ne connaîtra jamais assez le Bastiat pamphlétaire. C'est celui de "Ce que voit et ce qu'on ne voit pas". (2)⇓ Sa mordante ironie déjoue tous les "Sophismes économiques". (3)⇓
Son honnêteté intellectuelle lui permet de répondre de façons convaincante à tous ses contradicteurs. Signalons à cet égard sa correspondance avec Proudhon, sur la question du crédit gratuit en particulier.
À la fin de sa vie il dressera une approche théorique complète de son regard sur l'économie politique. Il fait regretter que cette formulation, malgré son brio et sa clarté reste la partie la moins connue de son œuvre.
Bien avant l'école autrichienne des disciples de Carl Menger (1840-1921) il s'est, en effet, détourné des conceptions matérialistes de la production sur lesquelles reposait largement la pensée des "classiques". C'est en effet à leur suite que Karl Marx développa sa théorie erronée de la valeur travail. Celle-ci ne fait que systématiser les approches rustiques de cette économie politique anglaise qu'il entend assaisonner de socialisme français et de philosophie allemande pour bâtir ce qu'il appelle "socialisme scientifique".
C'est donc à cela que répondent les "Harmonies sociales".
Le volume des "Harmonies sociales" vient d'être réédité : il fait suite à celui "Harmonies économiques". Dernier texte publié du vivant de l'auteur, il constituait un véritable petit manuel mettant les théories de propriété privée et de liberté économique à la portée de tous.
Ces "Harmonies sociales" (4)⇓ conclusion posthume de son œuvre, rédigée à Rome et publiée en 1851, forment le véritable testament intellectuel de Frédéric Bastiat. Elles répondent à la question des causes des "dissonances", ces tensions observables dans la société réelle et qui résultent de l'action du Spoliateur, – ce que nous pouvons analyser aujourd'hui à partir des excès du fiscalisme.
Voici comment l'auteur les présente :
"Nous avons vu toutes les Harmonies sociales contenues en germe dans ces deux principes : propriété, liberté. Nous verrons que toutes les dissonances sociales ne sont que le développement de ces deux autres principes antagoniques aux premiers : spoliation, oppression.
Et même, les mots propriété, liberté n'expriment que deux aspects de la même idée. Au point de vue économique, la liberté se rapporte à l'acte de produire, la propriété aux produits.
Et puisque la valeur a sa raison d'être dans l'acte humain, on peut dire que la liberté implique et comprend la propriété.
Il en est de même de l'oppression à l'égard de la spoliation.
Liberté ! Voilà, en définitive, le principe harmonique.
Oppression ! Voilà le principe dissonant ; la lutte de ces deux puissances remplit les annales du genre humain.
Et comme l'oppression a pour but de réaliser une appropriation injuste, – comme elle se résout et se résume en spoliation, c'est la spoliation que je mettrai en scène.
Notre tâche ne sera donc accomplie que lorsque nous aurons fait la complète monographie de la spoliation." (Frédéric Bastiat)
Il revient aux défenseurs de la liberté de terminer cette tâche aujourd'hui.
JG Malliarakis http://www.insolent.fr/2013/12/contestations-fiscales-et-harmonies-sociales.html
Apostilles
1) commandé par "Ouest France Dimanche" ⇑ 2) titre du recueil publié il y a 30 ans par les éditions Romillat disponible sur le site des Editions du Trident.⇑ 3) réédités aux Belles Lettres. D'excellentes Œuvres choisies avaient été publiées aux PUF. A noter que les Editions Charles Coquelin préparent une édition future des œuvres complètes ⇑ 4) disponibles sur le site des Editions du Trident ⇑