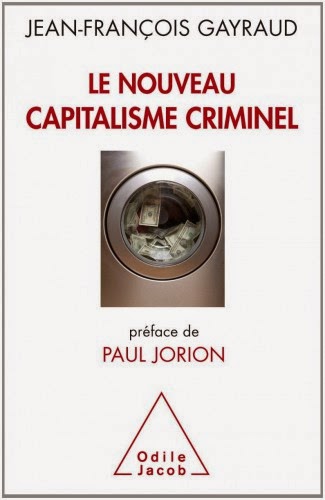 Le capitalisme financiarisé est-il criminogène ? La question a de quoi interpeller. Jean-François Gayraud, haut fonctionnaire de la Police nationale, la pose dans son dernier ouvrage, Le nouveau capitalisme criminel, une enquête troublante, à la croisée de la géopolitique, de la criminologie et de l’économie.
Le capitalisme financiarisé est-il criminogène ? La question a de quoi interpeller. Jean-François Gayraud, haut fonctionnaire de la Police nationale, la pose dans son dernier ouvrage, Le nouveau capitalisme criminel, une enquête troublante, à la croisée de la géopolitique, de la criminologie et de l’économie.Time is money
Derrière l’émergence du trading de haute fréquence, on retrouve les grands fonds spéculatifs et les grandes banques d’investissement, un lobby tout-puissant dont les pressions ont fini par être assimilées outre-Atlantique à de la « corruption légale ». Sans leur action, le high frequency trading n’aurait pu voir le jour. Ce sont eux qui ont aménagé un environnement juridique sur mesure. Une des pièces centrales du dispositif fut la décimalisation des ordres de Bourse, mesure en apparence anodine, mais qui allait modifier la taille des ordres en fractionnant quasi-indéfiniment leur valeur. L’autre grande nouveauté, c’est que les traders ont désormais la possibilité technique d’annuler plus de 90% des ordres qu’ils lancent. Il s’agit « d’ordres fantômes » (phantom orders) – des leurres – que Gayraud compare à des radars permettant de cartographier le marché en temps réel et donc de disposer de quelques millièmes de seconde d’avance sur lui. En 350 millisecondes (millième de seconde), un homme cligne des yeux ; c’est le temps nécessaire à un algorithme pour déclencher 7 000 transactions !
Time is money, répétait Benjamin Franklin. C’était au XVIIIe siècle et l’Amérique était déjà pressée – mais elle était encore en basse fréquence. Avec la haute fréquence, perdre ou gagner une seconde peut rapporter ou coûter la bagatelle de 100 millions de dollars. Les logiciels approchent aujourd’hui de la microseconde (millionième de seconde), bientôt de la nanoseconde (milliardième de seconde). Ce faisant, le marché évolue dans des échelles de temps quantique – une « course vers le zéro ». Le devenir Dieu du trading et son fantasme d’ubiquité totale. Dieu, le Diable, Lloyd Blankfein, le DG de Goldman Sachs – autrement appelée la « Firme » ou « Government Sachs », tant on retrouve ses cadres au sein de toutes les administrations, indifféremment démocrate ou républicaine – est un peu les deux à la fois. Il se flattait en 2009 auprès de journalistes de « faire le travail de Dieu ». On a voulu voir une boutade dans cette réplique. C’est bien pourtant un pouvoir démiurgique que possèdent les « too big to fail ». Car qu’est-ce que présenter un risque systémique, sinon disposer d’une arme aussi dissuasive que la bombe atomique ?
A ce stade, la question n’est plus de savoir si le trading de haute fréquence facilite ou non les comportements déviants : il est en lui-même déviant. Jean-François Gayraud n’est pas le seul à avancer cela. Une banque aussi peu suspecte d’anticapitalisme que le Crédit suisse a publié sur son site une étude (précipitamment retirée) soulignant son fort potentiel manipulateur et prédateur :High Frequency Trading. Measurement, Detection and Response. Les techniques de manipulation des cours sont légion. Il y a d’abord celle de la saturation, appelée le quote stuffing (« saturation, leurre, bourrage de cotations ») : on inonde le marché d’ordres fantômes. L’effet recherché ? On mystifie les autres donneurs d’ordres, on dissimule ses intentions et on congestionne le marché. En 2010, 75% des actions cotées aux Etats-Unis ont subi une attaque de ce type. Autre technique : le spoofing (« escroquerie, mystification ») et le layering (« superposition »), qui visent à déstabiliser les carnets d’ordres et à influencer provisoirement les cours par un afflux massif d’ordres trompeurs, l’objectif inavoué étant de réaliser une transaction en sens inverse.
700 milliards de dollars en 10 minutes
Il y aussi les petits arrangements entre amis, ce que le procureur de l’Etat de New York, Eric Schneiderman, a appelé les « délits d’initiés2.0 ». Le FBI a pu apporter la preuve, mais sans qu’une instruction soit ouverte, que des agences de presse comme Bloomberg et Thomson Reuters donnaient à leurs clients les plus fortunés un accès privilégié à leurs données économiques. Pour l’anecdote, mais c’est une anecdote à plusieurs millions de dollars, l’agence Thomson Reuters, qui avait signé un contrat d’exclusivité avec l’Université du Michigan pour être la première à publier son indice de confiance du consommateur américain, négociait ensuite cette exclusivité au plus offrant. En pratique, Thomson Reuters rendait publiques les données sur son site le jour dit, soit 10 heures précises. Mais dans les faits, l’agence les diffusait en accès prioritaire auprès de ses clients premium à 9 heures 55. Quant à l’élite de l’élite, les fonds spéculatifs, ils recevaient l’information à 9 heures 54 minutes et 58 secondes. Dans ce minuscule intervalle, des dizaines de millions de dollars changeaient de mains. Thomson Reuters a dû mettre un terme à cette pratique en juillet 2013. Officiellement. En réalité, ces « fuites » sont si nombreuses que les administrations américaines sont contraintes de régler leurs communiqués de presse sur des horloges atomiques.
« L’erreur est humaine, mais, pour vraiment se planter, il faut un ordinateur ». Le proverbe fait actuellement fureur à Wall Street, qui attend toujours aussi sereinement la prochaine apocalypse que son inconséquence aura déclenchée. La fin du monde a failli survenir le 6 mai 2010, à ce jour le seul krach majeur imputable au trading de haute fréquence. A 14 heures 32, un grand fonds d’investissement vend via son programme informatique 75 000 contrats pour une somme de 4,1 milliards de dollars. Dans la foulée, l’indice Dow Jones s’effondre de 1 000 points. En l’espace de 10 minutes, le marché perd, puis regagne 700 milliards de dollars. Du jamais vu de mémoire de trader ! Il faudra une suspension des cotations pour mettre un terme à l’emballement. « Le déclin, puis le rebond des prix sur un des principaux marchés, le 6 mai, fut sans précédent par sa vitesse et son ampleur », avouera la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la Bourse américain, qui concédera que cette journée ne fut pas perdue pour tout le monde.
Les incidents de type minikrach (flash crash) sont quant à eux si nombreux et si fréquemment liés au trading de haute fréquence que ce dernier est systématiquement pointé du doigt, même quand sa responsabilité n’est pas engagée. Ils n’ont pour l’heure aucun effet systémique, mais qui se risquerait à écarter des scénarios du type « cygne noir », ces événements imprévisibles à faible probabilité, mais aux conséquences désastreuses ? L’un des meilleurs et plus lucides criminologues financiers américains, William K. Black, expert au FBI, envisage très sérieusement une « série de défaillances en cascade » : « le 11 septembre ou le Ground Zero » du trading de haute fréquence.
« Moins de régulation qu’au temps du Far West »
Depuis l’affaire Madoff, les agences de régulation se montrent un tantinet plus regardantes, mais elles ne vont pas au-delà de rares sanctions administratives. Rien au pénal. Le too big to fail (trop grosses pour faire faillite) se redouble donc d’un too big to jail (trop grosses pour être poursuivies). Bref, l’impunité totale. Par la bouche de son ministre de la Justice, l’attorney general Eric Holder, le gouvernement américain en a lui-même fait l’aveu en mars 2013 devant une commission sénatoriale : « Je crains que la taille de certaines de ces institutions [Holder parle de HSBC] devienne si grande qu’il ne soit difficile pour nous de les poursuivre ». Et de mettre en avant les périls qu’une action en justice ferait peser« sur l’économie nationale, peut-être même sur l’économie mondiale ». Moralité :« C’est le gouvernement qui admet avoir peur de poursuivre les très puissants – quelque chose qui ne s’était jamais produit même à l’âge d’or d’Al Capone ou de Pablo Escobar », comme s’en désola Matt Taibbi, dont les articles ont fait la gloire du magazine Rolling Stone.
« Vous êtes des bookmakers, et vous êtes soumis à moins de régulation qu’au temps du Far West », lança une sénatrice démocrate aux dirigeants de Goldman Sachs lors d’une audition de la banque devant une commission d’enquête au moment de l’affaire Abacus, du nom de ce fonds « exotique » (comprenez : toxique) commercialisé par Goldman Sachs et créé par l’inénarrable Fabrice Tourre, un employé français de la banque. Noté « AAA », ce produit n’en était pas moins un vrai shitty deal (une « affaire de merde »), selon les mots mêmes de Tourre. Comme Kerviel en France, le trader servit de fusible à la banque, qui échappa aux poursuites, moyennant un dédommagement financier. Brillant, drôle et cynique, aussi arrogant qu’insignifiant, le personnage vaut le détour. Il se surnommait lui-même « Fabulous Fab » et offrait maintes ressemblances avec Patrick Bateman, le héros d’American Psycho, le roman de Brett Easton Ellis, qui met en scène un golden boy, accessoirement psychopathe. Un mouton noir ?C’est ce que le système voudrait nous faire croire.
Le crime parfait
Les derniers rebondissements de l’affaire Kerviel vont peut-être changer la donne. En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, qui imputait l’ensemble des fautes à Jérôme Kerviel, la Cour de cassation va-t-elle relancer la question de la responsabilité de la banque (et des banques) ? Qui le sait ? On restera cependant loin du compte. La justice cherche des coupables, alors que c’est tout un système qui a failli, un système à l’intérieur duquel la fraude est génétiquement inscrite. Elle en est pour ainsi dire la signature anonyme. C’est ce que signalait déjà Jean de Maillard, vice-président du tribunal de grande instance d’Orléans, dans L’Arnaque, La finance au-dessus des lois et des règles (Gallimard, 2010). Face aux tricheries généralisées, les agents du FBI, et à leur suite tous les analystes financiers, en arrivent à la même conclusion : c’est comme s’ils étaient confrontés au crime organisé... mais sans syndicat du crime. Le crime parfait.
Eléments n°151
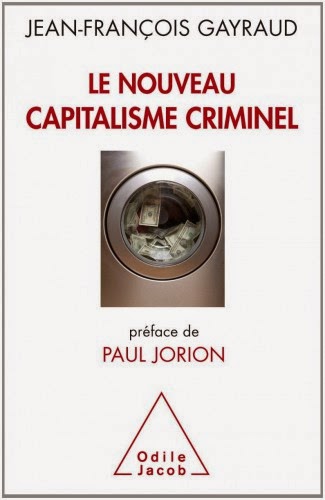 Le capitalisme financiarisé est-il criminogène ?
Le capitalisme financiarisé est-il criminogène ?