géopolitique - Page 612
-
Politique & Eco N° 158 avec Jean-Michel Vernochet : La guerre civile froide
Lien permanent Catégories : actualité, économie et finance, géopolitique, international 0 commentaire -
Erdogan se déclare continuateur de l'empire Ottoman
Le 10 janvier à Istanbul, le président turc Erdogan s'exprimait dans le cadre d'une cérémonie au palais Yildiz pour le centenaire de la mort du Sultan Abdulhamid II.
Ni le lieu, ni le monarque ne doivent être tenus pour fortuits : ils représentent ce que l'on peut considérer comme les symboles les plus éloignés de notre culture de cet empire que l'on croyait défunt.
Yildizi Sarayi, le palais de l'Étoile fut certes construit sous la direction de l'architecte italien Raimondo d'Aronco : en fait le 34e sultan de Constantinople craignait les vieilles résidences impériales de Topkapi et de Dolmabahçe qu'il jugeait trop proches du Bosphore et de la Corne d'Or.
Ce souverain terrible, Abdulhamid II (1876-1909), fils cadet du sultan Adulaziz (1861-1865) a mis en effet un terme à l'œuvre réformatrice de ses prédécesseurs commencée sous le règne d'Abdül-meçid (1839-1861), refusant d'appliquer la constitution, qui n'entrera en vigueur qu'après la révolution jeune-turque de 1908-1909.
En 1876 il avait obtenu que soit écarté son frère aîné Mourad V. Celui-ci ne régna que 3 mois ; il sera présenté pour fou, alors qu'en fait, adepte de la franc-maçonnerie, il entendait continuer le programme de réformes de ses 3 prédécesseurs, connu sous le nom de Tanzimat. Cette œuvre de réorganisation avait été préfigurée dès 1830 : cette année-là, où fut reconnue l'indépendance de la Grèce, le sultan-calife Mahmoud II (1808-1839) avait publié cette déclaration officielle : "Je fais la distinction entre mes sujets, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l'église et les juifs à la synagogue, mais il n'y a pas de différence entre eux dans quelque autre mesure. Mon affection et mon sens de la justice pour tous parmi eux est fort et ils sont en vérité tous mes enfants."
Abdulhamid II au contraire cherchera à revenir sur tout ce qui tendait à rapprocher la Turquie de l'Europe.
S'il n'est mort qu'en 1918, il avait été d'abord relégué dans son palais par la première révolution jeune turque de 1908, puis déposé en 1909 et remplacé nominalement par son frère, le fantoche Reshad effendi qui régnera jusqu'en 1918 sous le nom de Mehmed. Le dernier sultan-calife Mehmed VI (1918-1922) s'enfuira, craignant d'être accusé de trahison après la victoire de Kemal et la proclamation de la république. Lui succédera, mais en tant que 101e calife seulement, de 1922 à 1924, Abdül-meçid II dont la fonction fut abolie au bout de deux ans, les actuels islamistes cherchant à la rétablir.
Entretemps Abdulhamid II avait créé en 1890 la milice dite "Hamidiyé". Recrutée dans les tribus montagnardes tcherkesses, kurdes, turkmènes, yeuruk et turcs proprement dits, ses principaux exploits consistèrent à massacrer et piller entre 1894 et 1896 les provinces arméniennes, valant à leur maître le surnom de Sultan Rouge. Le génocide arménien, qu'il est toujours légalement interdit d'évoquer en Turquie, ébauché sous ce règne, reprendra sous une forme plus industrielle, sous la direction d'Enver pacha et de Talaat pacha en 1915.(1)⇓
C'est donc en lui rendant hommage qu'Erdogan, a cru pouvoir déclarer : "la République turque est la continuation de l'Empire ottoman".
"La République de Turquie, comme nos états précédents qui étaient la continuité de l'autre, est aussi une continuation des Ottomans. Bien sûr, les frontières ont changé. Les formes de gouvernement ont changé. Mais l'essence est la même, le cœur est le même, même de nombreuses institutions restent les mêmes.", a déclaré
"C'est pourquoi, considère-t-il, le Sultan Abdulhamid est l'un des plus importants, des plus visionnaires et des plus stratégiquement conscients qui ont laissé leur marque au cours des 150 dernières années", a déclaré le président turc qui est allé un peu plus loin en notant:
"Trop de gens essaient constamment de commencer l'histoire de notre pays depuis 1923. Certaines personnes veulent nous couper de nos racines et de nos anciennes valeurs.
JG Malliarakis
À lire en relation avec cette chronique
"La Question turque et l'Europe" par JG Malliarakis à commander en ligne aux Éditions du Trident, sur la page catalogue ou par correspondance en adressant un chèque de 20 euros aux Éditions du Trident, 39 rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Apostilles
- Enver pacha interviendra au congrès de Bakou cf. mon petit livre "La Faucille et le Croissant" Islamisme et bolchevisme au congrès de Bakou⇑
-
Comment les djihadistes sont-ils jugés en Syrie ?

Le reportage va au-delà de l’illustration. Il a valeur d’expertise. Les reporters racontent leur expérience du terrain.
Découvrez “Profession reporter” dédiée à la question suivante : “Comment les djihadistes sont-ils jugés en Syrie ?”.
Lien permanent Catégories : actualité, géopolitique, insécurité, international, islamisme 0 commentaire -
Trump, « le président le plus extraordinaire de l’histoire américaine » ?

Par Fabrice Fanet, colonel (ER) de gendarmerie
Philippe Corbé, journaliste correspondant de RTL aux Etats Unis, a récemment sorti un livre sur la présidence de Donald Trump. Si certains passages militants sont évidemment présents, on découvre que Donald Trump est « le président le plus extraordinaire de l’histoire américaine » pour le journaliste.
Les déclarations et « tweets » de Donald Trump n’ont pas fini de rythmer la jacasserie planétaire entretenue par des médias bavards condamnés à « l’ouvrir pour ne pas être fermés. »
Qui aurait pu imaginer que des gazouillis (tweets) émis par un Trump, (une trompette ou familièrement un chic type), parviennent à être une carte redoutable dans le jeu du Président des Etats unis d’Amérique afin peut être de remporter la partie, to trump voulant dire jouer atout ?
A tel point que vient de paraître chez Grasset un livre sur les paroles et les mots de Donald intitulé « Trumpitudes », sous-titré « et turpitudes », pour ceux qui ne voudraient pas comprendre le jeu de mots et ne pas applaudir la condamnation politiquement correcte et universellement convenue de l’indigne squatter de la Maison Blanche. Pensez donc, un milliardaire populiste qui a osé battre une femme « progressiste » soutenue en personne par Obama, le sauveur noir du monde qui, soit dit en passant, n’est pas noir mais métis !
Et pourtant, la surprise est au rendez-vous dans la préface comme dans la postface de ce livre dans lesquelles Philippe Corbé, journaliste correspondant de RTL aux Etats Unis, est loin de s’abandonner à une dénonciation systématique et primaire des mots du Président Trump. Morceaux choisis.
Pour l’auteur, « ce sont ses mots qui ont fait de lui le président de la première puissance du monde […] Ceux qui ont cru que ses mots allaient le perdre ont perdu, ceux qui pensait que ce n’était que du bruit n’ont rien entendu, ceux qui ne l’écoutent plus risquent d’être encore surpris. […] La politique, c’est dire des choses aux gens. Lui a su parler et être écouté de ceux qui pensaient qu’on ne les entendait plus. […] Son pouvoir ce sont ces mots […] ces trumpitudes […] tantôt déroutantes, rageuses, cocasses, inspirées, angoissantes, simplistes, crâneuses, créatives, absurdes, menaçantes, narcissiques, mensongères ou grotesques ».
[…]
« Il faut l’écouter, le lire, résister à la lassitude et à la répétition, car cette matière est fascinante. Quoiqu’on pense des promesses, des accomplissements ou même de la personnalité de Donald Trump, ses mots offrent […] un accès direct, immédiat et souvent sans filtre à sa pensée, ses peurs, ses colères, ses joies, ses ambitions, bref à sa nature intime. Jamais auparavant un homme aussi puissant n’avait pris le risque de laisser ses mots révéler de façon aussi crue qui il était ».
[…]
« Le 21 juillet 2016 […] le soir du discours aux accents nixoniens du candidat Trump pour clôturer une convention jusque là un peu terne […] j’ai ressenti physiquement, le long de ma colonne vertébrale, jusque sur les poils de mes mains, l’écho puissant de ses mots ».
Enfin la dernière phrase du livre mais non la moindre : « Un jour, plus tard, quand l’Amérique sera « great again », que ce « carnage américain » [ndlr : expression prononcé par le nouveau président lors de son investiture] aura pris fin comme il l’a promis, on nous demandera, n’aviez-vous pas vu ? N’aviez-vous pas entendu ? Tout est dit. Tout est là. Il suffit d’écouter comment il nous parle. »
Après ça, on s’attend à lire une analyse honnête et balancée des déclarations et de l’attitude de Donald Trump, et non comme d’habitude une condamnation automatique et systématique.
« Damned ! », il n’en est rien.
Le livre est composé comme une chronique totalement à charge décrivant les jours où le président Trump occupe le devant de la scène médiatique.
Ainsi le dimanche 29 janvier, l’auteur donne en 8 lignes une version très négative du décret sur l’immigration. « Depuis plus de 24 heures, c’est le chaos dans les aéroports où les agents ne savent comment appliquer le décret sur l’immigration signé par le président sans préparation de son application. » En appui de sa description, il cite les opposants à cette mesure, avant de reproduire sans commentaire 2 tweets de Donald Trump.Autre exemple (in extenso) où Trump apparaît comme un président dilettante qui réagit face aux Russes avec légèreté ou tout au moins avec un humour déplacé. En outre, Philippe Corbé y affirme péremptoirement que les russes sont intervenus dans l’élection américaine :
« Jeudi 10 août. Jour 203.
Masse salariale.
Donald Trump au Trump national Golf Club, Bedminster, New Jersey
Vladimir Poutine ordonne que 755 employés des services diplomatiques américains en Russie cessent leur activité, soit plus des deux tiers du personnel. C’est la réponse du Kremlin aux nouvelles sanctions votées par le Congrès après les interventions Russes dans l’élection. Le président trump les a critiquées publiquement, [ndlr : la construction de la phrase est telle que l’on ne sait pas s’il s’agit des sanctions ou des interventions…] et offre aux reporters son commentaire sur cette décision de son homologue russe.
Trump- je veux remercier parce que nous essayons de réduire notre masse salariale. »
En fait, tout au long de cette chronique qui se déroule du 20 janvier au 13 décembre 2017, Donald Trump est décrit sous les traits caricaturaux habituels : un président amateur, vulgaire, dangereux, anormal, raciste, etc.
Il n’en reste pas moins qu’en prenant de la distance face aux commentaires conformes et convenus de l’auteur (qui n’aurait d’ailleurs pas été publié chez Grasset sans cette révérence au politiquement correct), on peut suivre pas à pas les réactions d’un président hors du commun, « le président le plus extraordinaire de l’histoire américaine » comme l’affirme d’ailleurs Philippe Corbé en page 12.
Un président aux réactions instinctives et déconcertantes, pragmatiques et approximatives, suscitant l’étonnement positif ou négatif, la crainte ou une certaine admiration devant l’audace, attitudes qui correspondent bien aux descriptions que Philippe Corbé a eu la témérité (ou l’inconscience ?) d’écrire dans la préface et la postface de ce livre et même d’exprimer lors d’une interview vidéo postée sur le site du Figaro. Qu’il lui soit, de ce fait, beaucoup pardonné !
Fabrice Fanet 07/02/2018
Trumpitudes et turpitudes, Philippe Corbé, Grasset, 2018
Crédit photo : Gage Skidmore [CC BY-SA 2.0], via Flickr
https://www.polemia.com/trump-le-president-le-plus-extraordinaire-de-lhistoire-americaine/
-
Une enquête FBI en cours évoque les « millions » russes donnés par Moscou à la Clinton Foundation pour l’acquisition d’Uranium One

Selon la presse politique américaine, un informateur du FBI, Douglas Campbell, a témoigné devant trois commissions du congrès de l’existence d’importants virements de responsables exécutifs de l’entreprise nucléaire Rosatom sur les comptes de la Clinton Foundation afin de faire pression sur Hillary Clinton, alors secrétaire d’État des Etats-Unis. Moscou cherchait alors à acquérir la société nucléaire Uranium One et le fait est que les négociations ont abouti : avec l’approbation de Mme Clinton, la Russie a pu faire prendre le contrôle d’au moins 20 % de l’uranium américain – denrée stratégique entre toutes. Le rachat à 100 % a abouti en 2013. -
KRACH FINANCIER, PLUS-VALUE MARXISTE ET LIBRE-ÉCHANGE MONDIALISTE : REGARDEZ, CELA SE PASSE SOUS VOS YEUX !
Marc Rousset
Karl Marx partait du principe que l’unique objet des capitalistes étant d’accumuler un maximum de profits, ceux-ci seraient obligés de recourir au progrès technique pour produire à moindre frais. L’utilisation des machines venant à se substituer aux travailleurs nationaux, il en résulterait une croissance du chômage et donc un appauvrissement de la population.
L’utilisation éhontée, inique, complètement falsifiée de la théorie de Ricardo par les oligarchies financières a abouti à la folie du libre-échangisme mondialiste qui heurte le bon sens commun. Contrairement à ce qu’avait prévu Marx, plus qu’aux machines qui permettent d’accroître la compétitivité, c’est surtout à la course sans fin au prolétariat le plus misérable du Tiers Monde qu’ont recours les multinationales. Après la Chine, le Vietnam et le Bangladesh, elles commencent à penser à l’Afrique.
Il importe donc de rétablir la préférence douanière communautaire européenne et non pas hexagonale, ce qui serait suicidaire, pour tout produire d’une façon compétitive sur le sol européen ! Et les multinationales s’adapteront ! Non aux voitures fabriquées au Maroc par Renault pour alimenter le marché européen ! Seuls des droits de douane obligeront Renault et consorts à se soumettre à la volonté des peuples afin de garder leurs emplois !
Le nombre de milliardaires augmente dans le monde et les plus riches s’enrichissent tandis que les classes moyennes voient leurs revenus fondre ou disparaître. Le Directeur général d’une multinationale dont la fonction dépend de son conseil d’administration et dont le salaire dépend des « stock-options » directement liées aux cours de bourse, donc des profits, n’a d’autre choix que de délocaliser, d’où le chômage à terme et les déficits commerciaux. Le déficit commercial américain, malgré les efforts de Trump, est en hausse et a atteint 566 milliards de $ en 2017 dont 375 milliards avec la Chine et 71 milliards de $ avec le Mexique.
Et pour relancer la demande, suite au chômage structurel, les gouvernements croient ne pas avoir d’autres choix que d’augmenter les dépenses publiques, ce qui en fait alourdit les charges fiscales ainsi que la non-compétitivité, et surtout de déverser, à l’aide des banques centrales un déluge gratuit de création monétaire pour alimenter le moteur économique. Il en résulte une croissance artificielle et surtout une augmentation folle du prix des actifs, avec une spéculation effrénée. En jouant au pompier pour l’économie réelle, les banques centrales allument des incendies sur les marchés financiers.Le taux de la dette française est passé en quelques mois de 0,6% à 1%. Quid s’il atteint son niveau long terme de 6% ? La banqueroute de la France, de Macron et de son gouvernement avec une explosion sociale à la clé ! Le Dow Jones a dévissé au plus bas de 6,6% le 5 février 2018. La hausse des salaires aux USA a fait craindre un retour de l’inflation et quatre ou cinq hausses d’intérêt par la Fed en 2018. Le taux de déjà 2,72% dans un pays ayant recours aux taux variables, laisse aussi entrevoir une explosion de la marmite états-unienne.La méga-crise mondiale qui se prépare a commencé en fait en 2000 sur le plan financier et économiquement en 1971 avec Nixon lorsqu’il a décidé la non convertibilité du dollar en or, ce qui équivalait à ouvrir la boite de Pandore du laxisme universel. Nous vivons donc depuis 2000, une politique cyclique des taux d’intérêt accompagnée d’une augmentation structurelle de l’hyper-endettement.
En fait les gouvernements ne font qu’acheter du temps en repoussant l’échéance fatidique et en aggravant le problème. Même chose d’ailleurs pour l’invasion migratoire et le grand remplacement en cours ! Henri Queuille a de nombreux adeptes dans le monde ; très peu de De Gaulle, Churchill, Clemenceau ou Richelieu ! Macron ne peut être l’homme de la situation car formaté par la banque d’affaires et les « en même temps » de l’ENA !
Quand les fondamentaux économiques, sociétaux, moraux et civilisationnels d’une société sont mauvais, on achète de l’or pour s’assurer, surtout pas de bitcoin, et l’on vote pour une Droite nationale unifiée, européenne en faisant la révolution conservatrice des valeurs !
Lien permanent Catégories : actualité, économie et finance, géopolitique, international 0 commentaire -
Trump et Macron à Davos : deux visions du monde

Par Jean Goychman, Conseiller Régional Maine-et-Loire
Le Forum mondial de l’économie de Davos s’achève. Quels enseignements et quelles conclusions en tirer ? Cette réunion annuelle à laquelle tout ce qui compte (ou croit compter) à la surface de la planète se fait un devoir de s’y montrer. Certains le font avec une certaine discrétion, d’autres d’une manière très ostensible. L’essentiel étant d’y être.
Des avis partagés
Les commentaires des journalistes sur le Forum de Davos sont rarement unanimes. De fait, chaque commentaire reflète un peu la conception que son auteur se fait de l’évènement. On peut y voir une version « grand public » des conférences du Club des Bilderberg, mais cela entraîne inévitablement sur le terrain du complotisme, mot redouté de tous les « bien-pensants ». On peut également le considérer comme une sorte de rendez-vous de la bienfaisance, qui permettrait aux puissants de ce monde d’échanger avec les humanistes soucieux du devenir de l’Homme et de la planète… Pour ma part, je pense que c’est incontestablement un grand rendez-vous mondialiste. Je le situe dans la lignée du colloque de Walter Lipmann, le précurseur en 1938, puis la Société du Mont Pellerin en 1946, suivie du Club des Bilderberg en 1954, et enfin le Forum de Davos, inauguré en 1971, juste deux ans avant la naissance de la Commission Trilatérale en 1973.
Des centres de réflexion convergents dans leurs objectifs
Tous ces « think-tanks » participent de la même idée, mais différent quelque peu sur les moyens de parvenir à réaliser leur objectif. En clair, il s’agit d’assurer au plan mondial la primauté de l’économie sur le politique. Ceci ne se fera que s’il existe une autorité mondiale, sorte de « gouvernement » dont les membres ne seront naturellement pas élus, mais se coopteront au sein d’un groupe auquel l’accès sera volontairement limité. Le fondateur du Club des Bilderberg, David Rockefeller, n’en a jamais fait mystère depuis plus de 25 ans. Le Forum de Davos est, sans l’avouer explicitement, dans la même lignée. La Commission Trilatérale, très influente au niveau de la Commission Européenne (puisque beaucoup de commissaires participaient à ses travaux) a continuellement « orienté » les travaux de Davos, notamment sur la généralisation des zones de libre échange, processus par lequel un monde globalisé devrait apparaître. Le problème essentiel auquel les tenants de la mondialisation – qui veulent installer ce gouvernement mondial – doivent faire face est le manque d’engouement des peuples envers une autorité qui ne pourrait que les priver de leur souveraineté. Feu Peter Sutherland, pilier du Forum de Davos, n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de convaincre les gens qu’elle n’était qu’une illusion.
Un nouveau clivage mondial apparaît
Après la « guerre froide » de la seconde moitié du XXème siècle, une nouvelle ligne de fracture est en train d’apparaître dans le monde. Nous avons d’un côté une sorte d’élite mondialisée qui tire profit du libre échange généralisé, de la disparition des frontières et des mouvements migratoires et de l’autre, des peuples qui voient avec effroi leurs conditions de vie se détériorer. Les classes moyennes, issues du fameux ascenseur social que les démocraties avaient réussi à mettre en place ne fonctionne plus aujourd’hui. Le Forum de Davos met ce nouveau clivage en évidence.
Emmanuel Macron incarne cette élite mondialisée de la finance et du libre échange. Il prône habilement la souveraineté européenne, ce qui est un moyen de faire disparaître celle des nations qui constituent cette Europe. Il emploie le slogan « France is back », ce qui ne veut strictement rien dire, mais qu’il faut interpréter comme un signal donné à l’élite pour dire que la voie est libre aux investissements étrangers. Il tient un discours en anglais (la langue de Davos à 95%) devant un public conquis d’avance et enchaîne sur un discours en français, dans lequel il veut rassurer les français, et uniquement eux, sur ses intentions. En clair, cela s’appelle un double-langage.
De son côté, Donald Trump, qui a compris d’où venait le vent qui menaçait les mondialistes, prononce un discours très souverainiste, commençant par réaffirmer la supériorité du système américain et de la nation américaine, qu’il résume dans les mots « America first ». On peut noter que Trump n’emploie pratiquement jamais le terme « États-Unis » pour parler de son pays, mais celui d’« Amérique ». Cela marque son ancrage historique par un rappel de la « Doctrine de Monroe » (de fait, la doctrine de Monroe est antimondialiste car elle s’oppose à toute ingérence étrangère dans la politique américaine et constitue la base de l’isolationnisme américain. En clair, que chacun se débrouille…) qui établit d’une manière incontestable la souveraineté de l’Amérique et du peuple américain sur le continent.
On constate une TOTALE OPPOSITION AVEC LE PRINCIPE MÊME DE LA MONDIALISATION que certains commencent à appeler « globalisation ». Notons également que Trump conçoit que chaque chef d’État d’un pays souverain fasse de même et défende les propres intérêts de son État et de son peuple.
Le grand retour des peuples
De fait, Donald Trump inscrit son discours dans la Charte des Nations Unies de 1946 (avant que l’ONU devienne mondialiste) et fait également référence à la « Charte de la Havane » qui jetait les bases d’un commerce équitable entre les nations, les importations et les exportations devant s’équilibrer. Ce discours, qualifié de « populiste » par ses adversaires, trouve cependant un écho de plus en plus visible. Il suffit de regarder en Europe pour voir que beaucoup de peuples désirent reprendre en main leurs destins respectifs et croient de moins en moins à la construction européenne telle qu’elle est orientée. Ils tiennent à garder leur souveraineté et le contrôle de leurs frontières. On voit également que, en plus des États-Unis, la Chine et la Russie tiennent a peu près le même discours.
L’offensive du FMI et la future « guerre des monnaies »
Emmanuel Macron le sait. Et c’est bien la raison pour laquelle il lance la proposition d’un FMI qui devrait contrôler la monnaie mondiale. Jusqu’à présent, ce rôle est dévolu de facto à la Réserve Fédérale américaine et au dollar, et ce depuis 1971, lorsque l’abandon de la convertibilité de cette monnaie avec l’or a permis à cette dernière d’imprimer de la monnaie papier sans limite.
Emmanuel Macron sait parfaitement également que la Chine, la Russie, l’Iran et quelques autres pays tentent de faire émerger une autre monnaie internationale, afin de payer les transactions pétrolières. Or, la Chine est le premier importateur pétrolier du monde et c’est donc le dollar qui est directement menacé. De son coté, le FMI essaye de pousser en avant une autre monnaie, qui serait basée sur un panier de devises, et dont il exercerait le contrôle. Cela permettrait au fameux triptyque mondialiste (FED – FMI – Banque Mondiale) de garder la main.
Quel résultat pour la cuvée « Davos 2018 » ?
Ce Forum permet de constater, année après année, que la ligne de fracture entre les tenants du mondialisme et ceux du maintien de la souveraineté des États-nation apparaît de plus en plus nettement.
Et le problème risque de se compliquer singulièrement pour les mondialistes en raison de la montée en puissance de pays comme la Chine et la Russie, bien décidés à ne pas céder aux sirènes de la globalisation.
Jean Goychman 28/01/2018
Source : Minurne
https://www.polemia.com/trump-et-macron-a-davos-deux-visions-du-monde/
-
Les bobards de l’intervention occidentale en Libye et au Kosovo
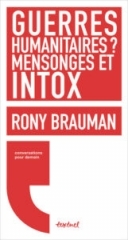 Marc Rousset
Marc RoussetQuelque chose est en train de bouger ou de changer dans le royaume de France. Il est ahurissant qu’ait pu paraître sur la page 18 entière du Figaro du samedi 3 février 2018 un dossier aussi accusateur et politiquement incorrect que l’interview de Rony Brauman, ex-Président de Médecins sans frontières, par le grand journaliste Renaud Girard, Normalien, adepte de la « Real Politik », épris très souvent de vérité et d’un sens minimum de l’honnêteté intellectuelle.
Rony Brauman vient en effet de faire paraître son ouvrage intitulé : « Guerres humanitaires ? Mensonges et intox» (éditions Textuel). Cette chronique dans le premier quotidien français pourrait être le point de départ d’une commission d’enquête parlementaire française sur les mensonges politico-médiatiques lors de l’intervention en Libye. Les accusations de Rony Brauman sont d’autant plus graves que le Parlement britannique a mené une enquête qui a confirmé la réalité des bobards. L’ancien Président Obama a pu qualifier l’expédition en Libye, tant vantée pourtant par Hillary Clinton, de « plus grande erreur de sa présidence ».
Les bobards dépassent en intensité ceux des armes de destruction massive de Saddam Hussein pour justifier l’intervention américaine en Irak. On peut mieux comprendre à la lumière de cet ouvrage l’indignation des Russes et le désir de Poutine de ne pas être de nouveau le dindon de la farce en Syrie.
Contrairement à ce qui a été prétexté, la rébellion armée de Benghazi était parfaitement à même de se défendre et de protéger son territoire. Personne n’a jamais vu, à supposer qu’elle ait existé, la prétendue colonne de chars de Kadhafi. IL n’était de toute façon pas nécessaire de commencer une guerre ; de simples survols de la « colonne fantôme » ou des tirs d’arrêt auraient suffi.
Le colonel Kadhafi qui prétendait dans ses discours enflammés aller chercher les opposants « ruelle par ruelle », n’avait pas les moyens d’écraser la rébellion de Benghazi. L’attaque de manifestants à Tripoli par les avions de Kadhafi n’a également jamais eu lieu. Sarkozy, Cameron et Obama ont pu cependant déclarer : « Un chef d’Etat qui envoie son aviation contre son peuple n’est plus digne de gouverner ; il doit partir ».
De même les charniers de Benghazi et de Tripoli n’ont jamais existé. Le représentant de la ligue libyenne des droits de l’homme faisait pourtant état de six mille morts ensevelis à la hâte en une dizaine de jours. La quasi -totalité des médias, des hommes politiques et des intellectuels ont repris et divulgué en 2001 cette fausse information.
IL y a ceux qui voient ce qu’ils croient et ceux qui, comme les patriotes, croient ce qu’ils voient. La guerre était en réalité voulue par l’Occident. IL s’est passé seulement 5 semaines entre la première manifestation à Benghazi du 15 février 2011 et l’attaque aérienne française du 19 mars. Toutes les tentatives de médiation (Union africaine, Turquie, Sénégal, Afrique du Sud) ont été repoussées. Voilà ce que le politiquement correct et l’infâme BHL appellent une guerre juste !
A noter qu’il en en été de même pour la guerre déclenchée par l’Otan en mars 1999 qui a bombardé pendant 83 jours Belgrade et les populations civiles serbes alors que la Serbie souhaitait reprendre le contrôle du Kosovo, son berceau mythique ancestral avec ses monastères, perdu le 28 juin 1389 face à l’empire ottoman lors de la bataille du Champ des Merles, envahi par l’immigration d’origine albanaise devenue majoritaire.
La véritable raison de l’agression par l’hyper-puissance américaine était alors le désir de justifier le maintien de l’organisation militaire de l’OTAN, de narguer les Nations-Unies, la Chine, l’Europe et la Russie, d’affaiblir l’Europe en favorisant le multi-ethnisme et l’islam, de poursuivre l’expansion militaire à l’Est et d’implanter la plus grande base militaire hors des Etats-Unis de « Bondsteel » forte de 10 000 hommes.
Le droit de l’hommiste Bill Clinton avait eu alors le toupet de dire : « Nous intervenons pour édifier un Kosovo pacifié et multi-ethnique ».
Lien permanent Catégories : actualité, géopolitique, international, lobby, magouille et compagnie 0 commentaire -
Serpent de mer ?

par Louis-Joseph Delanglade
Algérie, Maroc et Tunisie n’ont cessé depuis leurs indépendances de constituer un des grands sujets d’intérêt, voire de préoccupation ou d’inquiétude, de notre politique étrangère. D’ailleurs, à la suite de M. Giscard d’Estaing, pas un seul des présidents successifs n’a manqué de se rendre au Maghreb, dans tel ou tel des trois pays, parfois les trois, toujours pour des annonces de lendemains communs qui chantent. Une sorte de serpent de mer. Ce qui est nouveau avec M. Macron, si l’on en croit la tonalité de ses deux discours de Tunis (l’un aux députés tunisiens, l’autre aux Français de Tunis), c’est que le conditionnel serait plus satisfaisant : les lendemains pourraient chanter…
Si ses prédécesseurs ont tous souligné le côté souhaitable et même nécessaire de la coopération entre les rives nord et sud de la Méditerranée, M. Macron a le mérite d’avoir compris que, sauf à se contenter de mots, cette coopération doit être structurée. Il a même envisagé la possibilité, dès cette année, d’une réunion euro-maghrébine à Paris, pour avancer dans ce sens. Mais il ressort aussi de ses propos, plus ou moins mais suffisamment pour se révéler dommageable, qu’il associe toujours l’Europe, sous sa forme bruxelloise, à la France et qu’il donne, même en y mettant les formes, des leçons aux uns et aux autres.
Pour réussir, une telle ambition politique doit d’abord être circonscrite. Sans remonter très loin dans le passé, il semblait en 2008, à en croire le très optimiste M. Sarkozy, que son Union pour la Méditerranée, forte de ses quarante-trois membres (vingt-huit Etats de l’U.E. et quinze d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et d’Europe du Sud-Est) allait être le remède à tous les maux de la région. Dix ans après, c’est au mieux une usine à gaz. Projet trop ambitieux sans doute et surtout sans bases solides. En revanche, les données conjuguées de l’Histoire et de la géographie physique et humaine (ce dernier point est capital) incitent à envisager, avec les trois pays sus-cités, une forme d’union de la Méditerranée occidentale, à laquelle pourraient, devraient même, être conviés nos voisins européens d’Italie et d’Espagne. Diluer un tel projet en y associant d’autres pays d’Afrique ou d’Europe le viderait de son sens.
Pour réussir, il conviendrait aussi de se garder de tout néo-colonialisme idéologique. Or les discours tunisiens de M. Macron font la part trop belle à l’étalon de la bonne conduite démocratique. Sans doute peut-il paraître habile, à Tunis, de flatter le seul pays arabe qui ressemble un peu aux démocraties européennes. En revanche, la monarchie alaouite n’a aucune leçon à recevoir de M. Macron, pas plus d’ailleurs que le pouvoir algérien. Distribuer (ou pas) des bons points démocratiques à d’éventuels partenaires serait ridicule et contre-productif : comment ne pas comprendre en effet qu’au vu de la montée du salafisme toute logique démocratique et droit-de-lhommiste est dangereuse et, de toute façon, vouée à l’échec ? C’est, au contraire, en privilégiant relations et accords entre les Etats qu’on luttera efficacement contre l’islamisme, contre l’immigration sauvage et pour un développement harmonieux et apaisé de la zone.
Un peu plus de réalisme et de pragmatisme, un peu moins d’européisme et de démocratisme : cette condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, s’impose à l’ambition méditerranéenne de M. Macron.
-
Alep, Pyongyang, Davos… Vers la chute de l’Empire américain ?
Par Michel Geoffroy, essayiste
L’année 2017 restera comme un grand tournant géopolitique que les médias de propagande se gardent bien de nous révéler : celui de la fin, en direct en quelque sorte, de la domination des Etats-Unis sur la scène mondiale.
Les médias mainstream nous cachent ce tournant car c’est une mauvaise nouvelle pour la Super Classe Mondiale qui comptait sur la surpuissance américaine pour faire avancer son projet mondialiste !
Analyse d’une chute en direct.Corée du Nord : le roi est nu
Première étape, la Corée du Nord : un tout petit Etat de 25 millions d’habitants qui s’est doté non seulement de l’arme nucléaire mais de missiles intercontinentaux. Une nouvelle illustration de l’incapacité des Occidentaux à conserver leur monopole nucléaire, mais pas seulement.
En effet, Donald Trump peut toujours prétendre avoir « un plus gros bouton » que Kim Jong Un. Mais tout le monde voit que les gesticulations américaines n’ont pas permis de mettre au pas la minuscule Corée du Nord. A la différence de 1962, lors de la crise des fusées de Cuba, où les Etats-Unis ont fait plier l’URSS, qui était un adversaire d’une toute autre dimension que le pays du matin calme, même en version soviétoïde. L’Amérique de Donald Trump en est même réduite à demander l’aide diplomatique de la Chine et de la Russie pour tenter de résoudre la crise !
L’affaire coréenne ébranle surtout la crédibilité de la puissance américaine dans cette partie du monde au point d’inquiéter sérieusement l’allié japonais, qui songe à renforcer ses forces d’auto-défense et donc à revenir sur son pacifisme constitutionnel.
L’onde de choc coréenne n’a donc pas fini de se propager en Asie, car tout le monde comprend que le roi est nu….Syrie : échec au roi
Seconde étape, la fin de Daesch en Syrie du fait de l’intervention militaire russe, symbolisée par la reprise d’Alep.
Alors que les Occidentaux en ont été bien incapables, d’autant qu’ils voulaient avant tout le renversement de Bachar El Assad et qu’ils n’hésitaient pas pour ce faire à s’appuyer sur des groupes islamistes comme Al Nosra, présentés comme des forces démocratiques d’opposition. Gribouille n’aurait pas fait mieux !
La Syrie marque une nouvelle défaite stratégique des Etats-Unis dans leur prétention à imposer leur « nation-building », c’est-à-dire en réalité le chaos au Proche Orient. Une nouvelle défaite aussi pour tous ceux qui se sont embarqués dans la folle stratégie américaine et singulièrement la France, qui a perdu le peu d’influence qu’elle avait encore dans ce pays. Une belle performance française donc, dans un pays autrefois placé sous son mandat !L’intervention russe en Syrie fut non seulement décisive et « souveraine » car elle mit un coup d’arrêt à la déstabilisation occidentale de la Syrie. Elle apporte aussi la preuve que la Russie est de nouveau un acteur international à part entière avec lequel il faut désormais compter. D’autant que l’intervention militaire russe a démontré, au grand dam de l’OTAN, les très grandes capacités militaires de ce pays y compris dans les hautes technologies. Pendant que les frappes américaines continuaient de tomber à côté des cibles visées et de multiplier les « bavures »….
Car, malgré l’enfumage médiatique permanent*, la puissance militaire américaine n’est plus ce qu’elle était. On finit par oublier par exemple que cela fait désormais 16 ans que les Etats-Unis pataugent en Afghanistan pour « lutter contre le terrorisme » : mais pour quel résultat exactement, sinon l’explosion du trafic de drogue ?
Davos : le roi est mort vive le roi !
Troisième étape : Davos en janvier 2018.
Car contrairement à ce que nous serinent nos médias de propagande, la révélation de l’édition 2018 du Forum Economique Mondial de Davos n’était pas Emmanuel Macron, récitant avec application et en anglais son cours libéral de « réformes » et de « flexibilité », en bon élève de l’oligarchie.
Non c’était la Chine qui donnait le ton y compris en matière de défense de l’environnement, d’autant que les Etats-Unis apparaissaient marginalisés avec leur retrait du Protocole de Paris !
Le représentant chinois n’a-t-il pas affirmé en outre que « la Chine aspire à construire un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouisse d’une paix durable, de la sécurité universelle et d’une prospérité partagée. Ayant cela à l’esprit, le gouvernement chinois assume aujourd’hui davantage de responsabilités à l’égard de la paix et du développement du monde » ? Se payant donc le luxe de reprendre à son compte, mais au second degré, le discours habituel des Occidentaux.
Une Chine qui, avec les autres Brics , déconstruit en outre patiemment la domination du dollar et desEtat-Unis dans les institutions financières internationales.A Davos on parle toujours anglais, mais désormais avec un fort accent chinois ou indien.
Bienvenue dans le nouveau monde !
Le XIXe siècle fut européen et anglais. Le XXe siècle fut américain. Mais, à l’évidence, le XXIe siècle sera différent : peut-être chinois mais surtout, comme on dit, « multipolaire », ce qui signifie que les Occidentaux n’auront plus les moyens d’imposer aux autres civilisations leurs intérêts et leurs lubies idéologiques. Et que les Etats-Unis vont perdre leur statut de surpuissance.
Cela permet d’ailleurs de comprendre la signification réelle des critiques médiatiques récurrentes portées des deux côtés de l’Atlantique contre la personne de Donald Trump : elles servent à essayer de cacher la nouvelle donne stratégique du monde aux Occidentaux, en faisant de Donald Trump un bouc émissaire.
Car ce n’est pas à cause de la prétendue « folie », « imprévisibilité » ou « maladresse » de son actuel Président, que les Etats-Unis perdent leur leadership. C’est tout simplement parce que nous changeons d’époque et parce que les rapports de force mondiaux ne sont plus les mêmes. Mais chut ! il ne faut pas réveiller les autruches occidentales.
Lors de son discours sur l’Etat de l’Union, le 30 janvier dernier, le Président Trump a ainsi affirmé « nous pouvons tout faire », dans une sorte de remake du « Yes we can » de son prédécesseur Barak Obama. Mais avec le nouveau monde qui vient, cette méthode Coué a peu de chances de fonctionner.
Et il serait temps que les Européens en prennent conscience, au lieu de continuer de se placer à la remorque d’un Oncle Sam de plus en plus vieillissant.Michel Geoffroy
04/02/2018* surtout à destination des Européens : il suffit pour s’en persuader de regarder les programmes des télévisions généralistes !
https://www.polemia.com/alep-pyongyang-davos-vers-la-chute-de-lempire-americain/
