Plus prompt à utiliser les médias aux ordres pour faire sa crise d'autoritarisme et orchestrer l’éviction d'un général que de soutenir les militaires blessés :
- Page 30
-
-
Vers la fin de l’agriculture industrielle ?
La nouvelle agriculture « agro-écologique » signe-t-elle la fin de l’agriculture industrielle ?
En tout cas, c’est ce qu’avance Madame Hillal Elver, juriste de nationalité turque, rapporteur(e) spécial(e) sur le droit à l’alimentation de l’ONU. Elle s’insurge contre les conséquences catastrophiques des pesticides sur les animaux, la nature et l’être humain.
Et pourtant ce débat est déjà vieux de 30 ans lorsque Madame Brundtland donnait la définition du développement durable dans son rapport. C’est ainsi que Madame Elver dira : « Être tributaire de pesticides dangereux est une solution à court terme qui porte atteinte au droit à une alimentation suffisante et au droit à la santé des générations actuelles et des générations futures. »
Donc, n’hypothéquons pas la santé des générations futures au profit d’une économie productiviste qui ne fait qu’appauvrir les sols !
La santé humaine et l’environnement sont en danger. 200 000 personnes meurent chaque année d’intoxication dans nos pays de grande consommation. Les maladies se développent : parkinson, alzheimer ou encore les troubles hormonaux. Et les États ne bougent pas…
Le principe de précaution s’appliquerait-il dès maintenant ? Il semblerait que oui car la Déclaration universelle des droits de l’homme subodore le droit de chacun à vivre dans un environnement sain (principe d’ailleurs réaffirmé dans notre charte constitutionnelle pour l’environnement). Ce principe de précaution considère que le droit à une nourriture saine s’applique dès aujourd’hui… pour demain, dixit l’ONU.
-
Homère : Les écrits restent ...
-
Christian Millau : le dernier galop d’un hussard
Philippe Pichon
EuroLibertés cliquez ici
 Brillant, aventureux, taquin, assez solide à la riposte, excellent à l’escarmouche, Christian Millau appartenait à quelque chose comme l’école de Roger Nimier. Rien n’était beau comme cet écrivain parmi les uniformes littéraires. C’était la ligne elle-même. C’était la race de ces gamins de vingt ou trente ans qui, en 1950, étaient vraiment les enfants de la République des Lettres.
Brillant, aventureux, taquin, assez solide à la riposte, excellent à l’escarmouche, Christian Millau appartenait à quelque chose comme l’école de Roger Nimier. Rien n’était beau comme cet écrivain parmi les uniformes littéraires. C’était la ligne elle-même. C’était la race de ces gamins de vingt ou trente ans qui, en 1950, étaient vraiment les enfants de la République des Lettres.À tout juste quatre-vingt-huit ans, Christian Millau était un « jeune homme ». Il n’était pas né de la dernière pluie, et même mieux, il était né un Jour de l’An, ce qui lui évitait d’être un ravi de la crèche. Millau était venu au monde littéraire entre les hussards de droite à la Roger Nimier et les chevau-légers progressistes à la Claude Roy. Il semblait avoir tout abordé avec une fantaisie égale – surtout le pain quotidien d’une interminable après-guerre.
Mais la vie et l’œuvre de cet écrivain tardivement reconnu, capable de romans de mal du siècle, portaient pour blessures profondes des épreuves privées et l’impossible paix. À son succès Au galop des hussards (Grand prix de l’Académie française de la biographie 1999, prix Joseph Kessel 1999) succédaient bien d’autres dont un Dictionnaire amoureux de la gastronomie, neuvième opus d’une œuvre déjà bien fournie. Désormais, le besoin de tendresse et de fraternité animait le romancier en quête de sens et de poésie dans un monde qui lui paraissait en manquer singulièrement.
Le journaliste buissonnier écrivain gastronome
Après avoir raconté avec malice, dans son Guide des restaurants fantômes (Plon, 2007), les ridicules de la société française, il récidivait avec un copieux volume comportant des entrées d’une grande drôlerie : un pavé « bleu hussard » bien servi de huit cents pages d’un journaliste buissonnier écrivain gastronome.
Par sa plume et par le passé, Millau a rempli plusieurs milliers de restaurants aussi vite et aussi sûrement que Josyane Savigneau a vidé Le Monde des livres de toute saveur littéraire. « La gastronomie n’est pas un dogme, mais, comme l’amour, un plaisir, dont il est normal de discuter », écrivait-il.
Bref, un élément de la culture. Millau, qui avait le gosier littéraire en pente douce, ne démystifiait pas la cuisine, il désacralisait les restaurants. Si François Villon, notre grand poète, n’avait été (de peu) son aîné, Millau l’eût invité dans une des « tavernes de vin » qui fleurissaient à Paris, au temps de l’amour courtois et eût apporté de friands morceaux. Certes, c’était le petit bout de la fourchette, mais il plantait juste.
Une seule oreille de cochon lui manque et tout est dépeuplé
Car, depuis ses débuts à Opéra, l’hebdomadaire culturel dont un certain Roger Nimier vient de prendre la direction en 1951, Millau trouve sa voie dans la chronique caustique et amusée de la littérature et de l’actualité : des périodiques célèbres ou confidentiels des années cinquante à Service littéraire aujourd’hui, la feuille de chou d’écrivains faite par des écrivains (et cuisinée par notre ami François Cérésa).
Christian Millau appartient, par les meilleurs de ses livres, à la tradition des écrivains « charnels », voués à une observation dépourvue de prédication. Il compose de brefs chapitres où, avec humour et gravité, il rêve sur un moment où le destin prend figure. Dans Paris m’a dit (de Fallois, 2000), la crise de l’homme mûr éclate au seuil de la mort et l’introspection se colore de tragique en même temps que d’épicurisme. Et quand Millau abandonne de sa légèreté toute française, c’est pour gagner en tendresse et en majesté. En effet, il appartient à cette version d’écrivains dont l’idéologie (pardon Christian !) ne rive pas l’art aux contingences de l’époque.
Malgré ses vingt ans en 1950, on trouverait difficilement en Christian Millau les aspects attendus, et en quelque sorte négatifs, de ce qu’il est convenu d’appeler « la génération de la défaite ». Nulle trace, semble-t-il, de cette prostration qui fut le lot de la plus grande partie de la jeunesse au temps des effondrements. Son romantisme et sa désinvolture aigüe ne sont pourtant pas sans rapport avec ce qui caractérise tout un secteur du roman français d’après-guerre.
Des années Solex aux années Mac Do’
Né à Paris d’un père français et d’une mère originaire de Moscou (Bons baisers du Goulag, Plon, 2004), le jeune Millau, tout en poursuivant ses études à Sciences-Po et à la Faculté de droit, entre en 1949 au Monde de Beuve-Méry, au service politique, dirigé par Jacques Fauvet. Après la disparition d’Opéra en 1952, il reste aux côtés de Nimier et de Jacques Laurent lors d’un parcours de journalisme littéraire qui le conduit simultanément à noircir avec talent les colonnes de Carrefour, Arts, duBulletin de Paris, duNouveau Fémina, de La Parisienne, de Candide pour devenir, après la mort tragique de Nimier en septembre 1962, rédacteur en chef adjoint au quotidien Paris-Presse où il couvre, notamment, les événements d’Algérie, les grands procès de l’OAS et, à Dallas, les suites de l’assassinat de Kennedy, avec le procès de Jack Ruby.
Il collabore à Paris-Match, Elle, L’Express, aux magazines américains Holiday et Esquire, avant de devenir l’assistant-réalisateur d’Orson Wells à Hong-Kong pour un documentaire que Pierre Lazareff fait projeter à « 5 Colonnes à la une ». Millau est un touche-à-tout.
De retour en France, il lance avec son partenaire, Henri Gault, les guides et le magazine Gault-Millau, sorte de Lagarde-et-Michard de la gastronomie et du bien vivre, entreprise (presque) philanthropique dont il quitte la présidence pour prendre sa retraite en 1995. Il a même le privilège rare d’être, entre-temps, le 42e Français à décrocher la « couv’» du Time depuis la création, au début des années 1920, du célébrissime hebdomadaire américain.
En 1995, commence une troisième vie : celle d’écrivain à temps plein. Dès son premier livre, Les Fous du palais(Robert Laffont, 1994) pour lequel il obtient le prix Rabelais, sa fidélité aux « hussards » le met à part. Le reste est connu, de Commissaire Corcoran (Plon, 2005) à Dieu est-il gascon ? (Le Rocher, 2006)
Un simple regard et la journée vide s’embrase
Une lumière d’or vient mourir sur la table d’un lieu où Millau n’est que de passage. Il y a là des gens, des gens en bout de zinc. Tout leur corps en témoigne. C’est un endroit où ils viennent parler, s’entendre, s’écouter depuis des lustres. C’est un petit bistrot de nulle part, ni de campagne ni de banlieue, un café de bord de route où il aime tant aller se perdre au gré des errances, des promenades et des hasards. En bruit de fond, une radio. Des ouvriers qui entrent et sortent.
De médiocres reproductions sur les murs, la sciure qui traîne sur le plancher, quelques verres vides sur une table et l’arrière-salle que l’on devine derrière l’étoffe d’un rideau, avec des bruits de pas, des mains de servantes que l’on aperçoit de temps à autre, le cartable de l’enfant posé au sol et le chat qui dort près du radiateur où trônait autrefois un vieux poêle. C’est un jour insensé dans une vie insensée, un temps où il ne se passe rien, où rien ne survient jamais et c’est pourtant la plus haute vie qui soit, la vie en bordure, en lisière du monde, la vie que remet en lumière le moindre rayon de soleil, le moindre regard qui se pose sur elle.
En effet, il suffit d’un regard, d’un simple regard et la journée s’embrase, les choses sont revivifiées. Ainsi ce marronnier dans la cour déserte d’une modeste auberge de province où Millau a fait halte. Une table, un vin frais, les pages blanches d’un tout petit carnet de rondes gustatives et il demeure des heures à contempler cet arbre, la bicyclette que l’on pose contre son tronc puis les mains qui l’emportent plus loin, de l’autre côté invisible de la rue. Il entend, sans le vouloir, les musiques d’une conversation, le choc des casseroles de cuivre dans une cuisine proche et seul le vent se dépose sur les pages, seul le vent, l’air frais, feuillettent les pages qu’un soleil adoucit mais il n’écrit pas, surtout pas.
L’écriture, ce sera pour plus tard ou ce sera pour jamais mais il est tout à cet arbre qui lui survivra sans doute et, en un tel moment, l’écriture est sans importance, d’aucun secours, car un livre s’écrit, justement, sous les phrases qui bruissent et lui échappent. On peut le dire ainsi : chez Christian Millau, le plaisir écrit un livre à sa place.
Saint-Tropez : Une campagne au soleil (De Fallois, 2002)
Bien sûr, je ne vous dirais pas comment j’ai rencontré Millau dans les couloirs du commissariat de police de Saint-Tropez où j’officiais, et où sévissait un chef de service aux allures de garenne déjà faisandé. Ce n’est pas rien de rencontrer l’un des derniers hussards. Nous devînmes amis, enfin, je crois, à en croire l’affection réciproque qui s’accumulait autour de verres de blanc pris sous la tonnelle de sa villa, La Vigne Saint-Anne. Je l’écoutais me raconter les hontes de la vie humaine qui sont aussi les génies de la littérature française, parmi lesquels un certain Louis-Ferdinand Destouches dit Céline se taillait la part délicieuse du lion maudit.
Christian écrivait ainsi chaque jour, dans le lit de cette errance, dans ce passage qui est mouvement et l’entraînait dans les endroits les plus délaissés où le battement même de la vie devient souvent imperceptible, à l’image de la mort glissant sous sa peau, lui interdisant de faire autre chose que d’aimer car la vie est trop brève pour entamer un autre chant que le chant de la célébration, de la vénération pour la beauté du monde établie n’importe où, en des lieux innombrables et, peut-être, innommables. Millau accueillait et il servait. Puis, aussitôt, il oubliait qu’il fut serviteur, mais il n’oubliait jamais d’accueillir. Vous m’entendez : jamais.
Adieu Christian, ou plutôt, à ce soir.
-
DEUX ANS DE PRISON FERME POUR S’ÊTRE DÉFENDU : À BEAUVAIS, LA JUSTICE EST ENCORE PASSÉE

Ce qui s’est passé à Beauvais, le 25 juillet dernier, dépasse l’entendement. Sauf, peut-être, pour des magistrats nourris au lait de la repentance.
La Justice est encore passée, et là où il se trouve actuellement, le buraliste de Lavaur doit se dire que, finalement, il n’est pas seul. Parce que ce qui s’est passé à Beauvais, le 25 juillet dernier, dépasse l’entendement. Sauf, peut-être, pour des magistrats nourris au lait de la repentance et de l’excuse.
Un homme de cinquante ans se promène dans son quartier lorsqu’il est abordé par une bande de « jeunes » qui lui ont proposé de la drogue. Ayant décliné l’offre, il reçoit la bordée d’injures habituelle. L’altercation tourne mal et, agressé physiquement, l’homme sort un couteau dont il semble savoir se servir, puisqu’il poignarde l’un des assaillants à la gorge. Puis il prend la fuite, poursuivi par la horde à laquelle quelques congénères se joignent alors, jusqu’au hall de son immeuble où il est passé à tabac. Le procureur évoquera à l’audience une « chasse à courre ». Les images de la vidéosurveillance confirmeront ces propos. L’homme s’en tire avec 45 jours d’incapacité de travail, ce qui n’est pas rien.
Jusque-là, il s’agit d’une scène banale dans certains quartiers. La suite l’est moins. Tout ce petit monde est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Beauvais. Et, si les jeunes délinquants sont condamnés à des peines de 10 à 18 mois de prison ferme, l’agressé, lui, écope de deux ans de prison. Deux ans pour avoir osé se défendre face à une meute décidée à en découdre !
Juridiquement, cette décision s’explique sans doute. Peut-être la victime, de même origine que ses agresseurs, était-elle connue pour des faits de violences, avait-elle un casier judiciaire ou provoquait-elle régulièrement les « jeunes ». Peut-être s’agissait-il d’une forme de règlement de comptes entre individus rivaux. En l’absence de tout communiqué du parquet, il est impossible de le savoir. À moins que le tribunal n’ait décidé, comme il l’a fait dans d’autres cas, de rappeler que la légitime défense n’est admissible que dans des conditions strictes, et doit être parfaitement proportionnée à l’agression. Dans ce cas, le fait de sortir un couteau aurait été considéré comme prématuré et excessif. En fait, l’homme aurait dû se laisser passer à tabac et, en l’absence d’arme dans les mains de ses adversaires, laisser son couteau dans sa poche…
Quels que soient les motifs de ce jugement, son effet est déplorable. Une fois encore, la Justice donne l’image d’une institution qui ne comprend strictement rien à ce qui se passe dans de nombreux quartiers. Elle continue à raisonner comme s’il suffisait de demander poliment à une bande de jeunes de passer son chemin, de faire appel à son sens de l’honneur en quelque sorte : on ne frappe pas un homme sans défense, plus âgé et solitaire… Elle semble penser que la police est partout, prête à intervenir, un peu comme dans les bandes dessinées de notre enfance, où un îlotier était toujours à proximité avec sa pèlerine et son sifflet.
Mais en rendant de telles décisions, nos juges minent chaque jour le sol de notre pays. Ils sèment des explosifs à retardement et seront les premiers à s’étonner le jour où ils péteront. Ils donnent aux bandes, aux cambrioleurs, aux agresseurs et aux criminels de tout poil un sentiment d’impunité. Confrontés à des individus pour qui l’autorité de la Justice ne signifie déjà pas grand-chose, ils leur délivrent un message clair : celui qui se défend contre vos entreprises sera condamné plus durement que vous. À Albi, à Beauvais, et partout en France.
Ils veulent soumettre les victimes à leur propre idéologie. Ils ne réussiront qu’à les faire se révolter. En oubliant les leçons d’une Histoire qu’ils ne connaissent plus : les premières victimes de la Terreur ont été les magistrats qui avaient consciencieusement préparé la Révolution, des décennies durant. En France, l’injustice ne passe pas, jamais. Ils devraient s’en souvenir.
http://www.bvoltaire.fr/deux-ans-de-prison-ferme-setre-defendu-a-beauvais-justice-passee/
-
Mémoires d'un allemand catholique de l'Allemagne nazie à l'Union soviétique
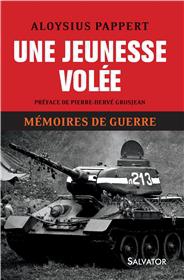 Aloysius Pappert est né en Allemagne, près de Fulda (Land de Hesse), en 1924, dans une famille catholique et antinazie. Contre son gré, il doit partir en guerre en Russie, alors qu’il a à peine 17 ans. Le jour de son départ, sa mère lui donne une médaille et le confie à la protection de la Vierge Marie pour qu’il revienne sain et sauf... Ses Mémoires de guerre évoquent son parcours en deux tomes : Une jeunesse volée et Le sang des prisonniers.
Aloysius Pappert est né en Allemagne, près de Fulda (Land de Hesse), en 1924, dans une famille catholique et antinazie. Contre son gré, il doit partir en guerre en Russie, alors qu’il a à peine 17 ans. Le jour de son départ, sa mère lui donne une médaille et le confie à la protection de la Vierge Marie pour qu’il revienne sain et sauf... Ses Mémoires de guerre évoquent son parcours en deux tomes : Une jeunesse volée et Le sang des prisonniers. Dans le premier tome de ses Mémoires de guerre qui courent jusqu’au 8 mai 1945, il offre un témoignage de premier plan sur la Seconde Guerre mondiale, celui d’un homme qui ne partageait pas du "caporal autrichien". L’oppression croissante du régime nazi sur les soldats et les civils, la honte et la défaite morale qui s’annonce sont déjà perceptibles.
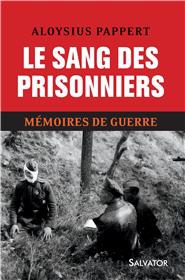 Dans le second tome, Aloysius Pappert, jeune officier de 20 ans, prend la tête de ce qui reste de sa compagnie dans l’espoir d’échapper à l’Armée rouge, traverser la Tchécoslovaquie et se rendre aux Américains. Commence pour lui une nouvelle épopée qui le conduira à la captivité dans les camps soviétiques... : longs déplacements en train, mouvements d’un camp à un autre et, plus largement, passage du régime nazi moribond au monde du communisme russe. Un exode où pourtant la foi du jeune Allemand ne faiblit pas.
Dans le second tome, Aloysius Pappert, jeune officier de 20 ans, prend la tête de ce qui reste de sa compagnie dans l’espoir d’échapper à l’Armée rouge, traverser la Tchécoslovaquie et se rendre aux Américains. Commence pour lui une nouvelle épopée qui le conduira à la captivité dans les camps soviétiques... : longs déplacements en train, mouvements d’un camp à un autre et, plus largement, passage du régime nazi moribond au monde du communisme russe. Un exode où pourtant la foi du jeune Allemand ne faiblit pas.Après son retour de captivité en Russie, Aloysius Pappert a commencé une nouvelle vie dans une Allemagne dévastée. Il a créé ses propres entreprises avec succès et s’est beaucoup investi sur le plan caritatif, en soutenant les missions chrétiennes dans de nombreux pays du monde. Aujourd’hui, à 92 ans, il vit à Monaco avec son épouse Isabelle avec qui il est marié depuis plus de soixante ans.
Il témoigne ainsi :
"Mes souvenirs de mes campagnes n'étaient pas ceux d'un ancien combattant qui fait étalage de ses faits d'armes et semble regretter le bon temps de la guerre. Non, ce que je voulais, c'était rappeler sans cesse pourquoi et comment j'avais pu traverser toutes ces épreuves, et il n'y avait qu'une seule explication : ma foi en Dieu. Non seulement ma foi, mais aussi son affirmation franche, quelles que soient les circonstances. Toujours, je m'étais intéressé à la place que tenait la religion dans l'armée, en dépit des réticences de mes supérieurs. On célébrait la messe, j'y allais. Un SS faisait régner la peur, j'affirmais que j'étais croyant et il s'inclinait devant ma détermination. Il devenait mon protecteur !
Tous mes récits n'avaient qu'un but : ramener les prisonniers à des sentiments religieux, protéger les vivants et respecter les morts, prier pour eux. C'est cela que je voulais transmettre à mon auditoire : l'importance de la foi en Dieu, en son fils Jésus-Christ et en la Sainte Vierge Marie, mère de Dieu."
-
POURQUOI L'IMMIGRATION EST-ELLE L'ABOUTISSEMENT DES VALEURS RÉPUBLICAINES ?
-
Herrou et ses pareils ne sont pas des Tartuffes mais des ennemis déclarés !

Par Jean de Maistre
Les commentaires se suivent et même se complètent sur Lafautearousseau. Celui-ci du jeudi 10 août fait suite aux commentaires reçus à propos de notre publication « Bravo, l'Italie ! Pas pour Saint-Nazaire ! Pour la Méditerranée ! ». Notamment celui d'Antiquus repris ici hier, en réponse à un commentaire d'Hugues Noël, auquel on devra se reporter ainsi qu'à notre article. (Lien ci-dessous). LFAR
Un excellent commentaire en effet. L'humanisme n'a pas grand chose à voir avec ce soutien à l'invasion migratoire et aux mafias qui l'organisent. On assiste à une volonté délibérée de détruire l'Europe, son identité, sa culture par l'installation d'une masse migratoire de plus en plus importante, issue des pays arabes et africains, immigration dont on sait aujourd'hui qu'elle refuse de plus en plus l'assimilation et constitue des enclaves ethniques sur le sol national, hostiles aux sociétés d'accueil.
Cette volonté est à la rencontre de plusieurs courants, le gauchisme qui veut punir l'Europe de ses '' fautes '' passées, de la colonisation et qui cherche vainement un prolétariat de substitution pour jeter à bas la société, depuis que le prolétariat de souche a accepté le monde tel qu'il est. Ce prolétariat de substitution, le gauchisme le trouve dans l'immigré, nouvelle divinité devant échapper à toute critique. Un autre courant est le libéralisme qui veut au nom de la mondialisation détruire les vieilles nations, seul cadre où les peuples peuvent encore avoir un semblant de contrôle sur leur destin. C'est la rencontre du gauchisme internationaliste et de la mondialisation libérale, voilà qui ne manque pas de sel.
Aux USA, les partisans les plus acharnés de l'immigration sans contrôle sont les libertariens, c'est-à-dire les ultra-libéraux, qui ne rêvent que de privatisation de tout, y compris de l'espace public, et de la destruction des frontières, afin d'avoir à disposition une main d’œuvre bon marché, comme lorsque les Anglais faisaient venir au XIX° siècle dans les usines de Manchester les irlandais chassés de leur île par la famine.
On remarquera que les richissimes émirats du golfe ont fermement déclaré qu'ils n'accepteraient aucun migrant. C'est à l'Europe et à elle seule de supporter le poids de l'invasion migratoire. Dans l'esprit des islamistes (ce n'est pas moi qui le dit, c'est eux ! ) l'arrivée de millions d'immigrés musulmans participe de la stratégie de la conquête de l'Europe déjà considérée par certains d'entre eux comme Dar al Islam, terre d'islam. Et l'on voudrait que les européens ne réagissent pas ? Si l'on veut installer dans nos vieilles nations qui n'en peuvent mais les prodromes de futures guerres civiles, il n'y a qu'à continuer ainsi.
Lire ...
Bravo, l'Italie ! Pas pour Saint-Nazaire ! Pour la Méditerranée !
-
Vive l'Europe : Adrien Abauzit et son livre, La France divisée contre elle-même (août 2017)
-
CELA S’APPELLE TOUT SIMPLEMENT UNE INVASION…

C’est arrivé le 7 août dernier à Ceuta, l’une des deux enclaves espagnoles (l’autre est Melilla) établies au Maroc depuis le XVesiècle et aux portes desquelles s’entassent depuis longtemps, guettant l’entrée dans le « Paradis », des foules de « remplaçants noirs » venus de l’Afrique subsaharienne. Plus de 200 d’entre eux ont tout simplement franchi en force la frontière entre le Royaume du Maroc et l’enclave en passant par la porte principale. Franchir en force : en un mot, cela s’appelle envahir…
En général, la police du roi Mohammed VI fait bien son boulot et aide ses confrères espagnols à empêcher ces intrusions. Mais là, elle n’a rien pu y faire. Imaginons la situation si un jour la monarchie alaouite devait fléchir sous les coups, par exemple, d’un quelconque « printemps »… Il vaut mieux ne pas y penser. C’est notre plus grande hantise, me disait récemment un habitant de Ceuta.
Rares en Europe sont les journaux qui relatent cette invasion et s’émeuvent de ce dernier assaut du 7 août. Et s’ils le font, c’est parce qu’un policier espagnol a eu les jambes cassées. C’est très bien, une telle émotion, mais il ne faudrait pas oublier les dizaines de policiers qui ont été également blessés au cours d’autres assauts contre le grillage de fil de fer barbelé construit en 1998, haut de six mètres et pourvu de deux clôtures parallèles qui courent, aussi bien à Ceuta qu’à Melilla, au long des douze kilomètres de frontière.
Il s’agit là d’un imposant rempart qui a pourtant été percé lors de plusieurs attaques particulièrement violentes et qui ont blessé aussi bien des envahisseurs que des policiers espagnols. Inutile de dire sur lesquels des deux sont tombées les larmes de la bien-pensance…
Or, il semblerait que les derniers renforcements apportés au grillage aient été assez efficaces, car depuis quelques mois, il n’y avait plus eu d’assauts… jusqu’à celui de l’autre jour, lorsqu’une foule de 200 remplaçants noirs ne se sont même plus donné la peine de grimper sur le haut des fils de fer barbelé afin d’en forcer le passage. Mais non, voyons, c’est trop risqué ! C’est beaucoup plus simple d’entrer en courant et en grande foule – il fallait y penser ! – par la porte d’entrée, là où, à cinq heures du matin, il n’y avait que trois ou quatre policiers qui, ayant l’interdiction d’employer leurs moyens de défense contre les agresseurs, n’ont évidemment rien pu faire, sauf se faire casser les jambes, pour empêcher leur passage.
Il est à espérer que les autorités espagnoles prendront les mesures nécessaires (de nouvelles barrières, d’autres grillages, un pont-levis, peut-être… que sais-je) pour empêcher qu’un telle ruse ne puisse se reproduire. Or, c’est autre chose qu’il faudrait surtout espérer voir mettre en œuvre – mais que les belles âmes et les collabos de tout poil soient rassurés : cela ne se fera pas. Il faudrait, surtout, espérer qu’on en finisse une fois pour toutes avec cette singerie hypocrite et procédurière par laquelle, dès qu’un envahisseur a touché le sol d’un pays, on ne peut plus le renvoyer illico là d’où il est parti.
Ce ne serait qu’alors qu’on pourrait ne plus voir des images aussi consternantes que celles qui nous sont offertes. On y voit, riant, sautant de joie, se roulant par terre et poussant des cris sauvages, après leur « exploit », ces « nouveaux Espagnols » : les derniers 200 remplaçants venus nous remplacer. Une goutte d’eau, c’est vrai, par rapport aux millions que nos oligarques vont incessamment laisser entrer chez nous.
Javier Portella Écrivain et journaliste espagnol El Manifiesto