Il y a longtemps que nous mettons en garde contre les risques de nos emprunts audacieux et de la dette abyssale de notre pays même s’il faut reconnaître que la pandémie virale que nous connaissons depuis plus d’un an en est aujourd’hui la cause principale. Mais cette situation n’est temporairement acceptable que si les taux d’intérêt restent bas, ce qui était le cas jusqu’à présent et permettait la fuite en avant de nos dirigeants. Mais la situation est en train de changer.
économie et finance - Page 262
-
Dette publique : la fin de l’argent gratuit et ses conséquences.
-
Zoom – Julien Langella : Préparer la révolution pour un populisme radical
« Refaire un peuple – Pour un populisme radical », voici un livre fondateur qui s’adresse à la nouvelle génération de cadres conservateurs et à tous les cœurs rebelles qui ne consentent pas à la mort programmée de leur civilisation. Renforcer leur structure de pensée et les pousser à l’action, c’est l’objectif assumé de Julien Langella, qui signe un manifeste ambitieux et fédérateur. S’y livrant à une critique approfondie du capitalisme mondialisé, il renvoie dos à dos la tyrannie de l’étatisme et la sauvagerie libérale. Résolument populiste et identitaire, il appelle de ses vœux une révolution du local contre le global, prélude à la renaissance de nos patries charnelles. Plus encore qu’un programme, c’est une exhortation à la pratique radicale et à l’action concrète, sur tous les fronts. Refaire notre peuple commence dès maintenant. À chacun d’y œuvrer sans relâche.
https://www.tvlibertes.com/zoom-julien-langella-preparer-la-revolution-pour-un-populisme-radical
-
GRAND EMPRUNT NATIONAL : FAITES VIVRE LA DÉMOCRATIE, SOUTENEZ VOS IDÉES !
-
MICHÉA - Le libéralisme
Michéa a produit une critique radicale de la pensée libérale, à contre-courant de la pensée officielle. En effet, pour lui, le libéralisme politique (ou sociétal) de la gauche et le libéralisme économique de la droite participent d'une seule et même dynamique philosophique. Analyse de cette conception.
https://www.agoravox.tv/culture-loisirs/culture/article/michea-le-liberalisme-89330
-
Sortir de l’économisme
Pour maîtriser les dérives de la société de consommation et de l’individualisme libéral, il s’agit de sortir d’un économisme étouffant et stérile.
Cet économisme est le fruit naturel et nécessaire d’une économie de marché qui est aussi ancienne que les grands marchés médiévaux ou le commerce des cités italiennes. Il n’est pas question de revenir là-dessus.
-
Craintes de krach dans la politique de fuite en avant de l’Occident
Marc Rousset
Après trois séances sur cinq en baisse, le Dow Jones, le NASDAQ et le S&P 500 n’ont finalement, respectivement, reculé cette semaine que de 0,46 %, 0,25 % et 0,13 %. Le taux américain de la dette à dix ans s’est assagi à 1,55 %. Quant au CAC 40, il s’est replié de 0,46 %, toujours en progression de 12,73 % depuis le début de l’année. Tout se passe comme si nous vivions, en Occident, la fuite en avant d’un monde économique, budgétaire, boursier et financier mortellement touché, atteint par une étrange maladie qui n’arrive pas à se déclarer, les hommes ayant eu recours à des méthodes exceptionnelles et non conventionnelles pour brouiller les pistes, mais qui, comme avec Frankenstein, peuvent les amener à perdre complètement les manettes de contrôle.
-
Covid : la financiarisation totale de l'économie
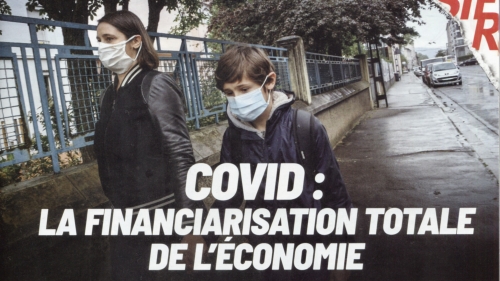
Depuis 1971, le Forum économique mondial réunit, tous les ans à Davos (Suisse), le gratin de élite mondialiste, décideurs politiques et économiques, PDG de multinationales, représentants des grandes institutions financières internationales, mais aussi intellectuels et journalistes, où se discutent les grandes lignes des politiques économiques mondiales.
L’objectif de l’oligarchie financière mondiale est donc le contrôle complet sur les économies des pays développés, les seules qu’elle puisse piller à grande échelle, ce que l’on pourrait appeler « la financiarisation totale de l’économie mondiale ».
-
Une drogue addictive : la dépense publique

La route paraît bien longue qui pourrait conduire l'Hexagone à une réforme de l’État. La suppression annoncée de l’ENA, – c'est-à-dire plus précisément, à ce jour, son changement de sigle puisqu'elle serait rebaptisée Institut du Service Public, – ne servira à rien. Peut-être même servirait-elle à jeter les bases d'une technocratie plus nuisible encore, si on ne se débarrasse pas d'abord de l'étatisme, considéré comme un pilier du modèle social français.
-
Les banksters préparent l’intérêt négatif dès le premier euro : le Great Reset va commencer
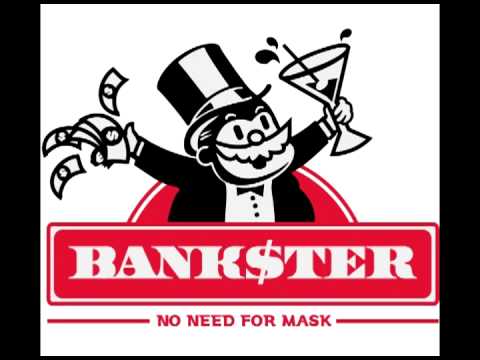
Il ne fait aucun doute que le coût de la plan-démie Covid-19 sortira d’une façon ou d’une autre de nos poches de contribuables et d’épargnants. C’est d’ailleurs explicitement écrit dans le projet de Great Reset signé par Klaus Schwab, dirigeant du Forum économique mondial. Et voilà que resurgit comme par enchantement l’idée de l’intérêt négatif sur nos comptes en banque.
Le site belge de RTL Info écrit ce matin :
Certaines banques, comme ING et TRIODOS, pratiquent depuis peu des taux négatifs sur les gros dépôts des particuliers et des entreprises ou se permettent même de transformer d’autorité des comptes d’épargne réglementés en comptes normaux pour éviter de devoir rémunérer le taux d’intérêt minimum de 0,11%.
-
Croissance économique : la fin d’une époque – Politique & Eco avec Guy de La Fortelle
Olivier Pichon et Pierre Bergerault reçoivent Guy de La Fortelle, économiste, éditeur pour son blog « L’investisseur sans costume » et sa lettre Risque et profit.A travers les analyses sur la monnaie depuis les étranges monnaies océaniques de l’île de Yap jusqu’au bitcoin, en passant par l’or, quelle est la nature de la monnaie, quels sont ses fondements, son coût de fabrication et que penser de la monnaie planche à billet ?